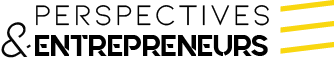En Europe de l’Est, les initiatives européennes, la politique monétaire et les réformes structurelles influencent les choix d’investissement en limitant l’incertitude, en favorisant le développement des infrastructures, et en accompagnant l’évolution des modèles productifs et énergétiques. Ces instruments modifient les perspectives de rendement, la perception des risques et l’environnement économique régional. Ces dynamiques ont des répercussions notables sur les flux vers l’Europe centrale et orientale, en particulier dans les secteurs de l’industrie, des technologies, de l’énergie et des équipements publics.
Découvrez les liens entre politiques publiques et arbitrages sectoriels – où les interventions produisent-elles le plus d’effets ? En quoi les taux d’intérêt, les programmes communautaires et les ajustements réglementaires réorientent-ils les décisions stratégiques ? Quels facteurs conjoncturels et institutionnels peuvent soutenir une hiérarchisation rigoureuse des projets ?
Sommaire
Contexte économique en Europe de l’Est et rôle des politiques économiques
Depuis deux décennies, les pays d’Europe centrale et orientale ont connu une évolution significative en matière de convergence économique: le PIB par habitant est passé d’environ 45 % de la moyenne européenne en 1995 à presque 80 % en 2023. Cette tendance s’appuie sur des facteurs multiples, dont l’ouverture commerciale, le soutien financier des programmes européens et l’adaptation progressive des structures productives.
Le recours aux fonds communautaires a permis de stimuler les investissements publics dans des proportions notables: ils représentent environ 13 % des montants investis sur la période 2014-2020, avec des pointes bien supérieures dans certaines économies moins avancées. Pour les investisseurs, plusieurs aspects sont à noter :
– Des réseaux d’infrastructure (transports, énergie, numérique) plus opérationnels, avec des gains sur les coûts logistiques et d’accès au marché ;
– Une attractivité accrue liée aux réformes de compétitivité et à une amélioration de la structure des marchés financiers ;
– Un impact en chaîne pour les PME et les entreprises européennes qui développent leur présence dans cette région.
Les crises successives (2009, pandémie) ont affecté les dynamiques d’investissement selon les secteurs. La Banque européenne d’investissement (BEI) a mis en évidence des insuffisances persistantes dans certaines filières (recherche, économie verte). Avec les ajustements géopolitiques récents, une partie des capacités industrielles et des centres de services s’est redéployée vers l’Europe de l’Est, dans des domaines demandant du capital humain qualifié.
Principaux dispositifs politiques impactant l’investissement
Fonds européens et Facilité pour la reprise et la résilience
Les programmes européens regroupant la politique de cohésion et la Facilité pour la reprise et la résilience, jouent un rôle incitatif structurant. Dirigés vers les infrastructures, le numérique, la diversification énergétique ou la modernisation industrielle, ces mécanismes auraient, selon la Commission, un effet multiplicateur économique estimé à trois euros de PIB pour un euro mobilisé à long terme. Sur la période 2014-2020, plus de 4 millions d’entreprises auraient reçu une forme de soutien, avec près de 370 000 créations de postes recensées.
Ces crédits participent à l’attractivité de projets industriels complexes, en réduisant les barrières initiales à l’investissement et en mobilisant des contributions privées.
Politique monétaire européenne
La politique monétaire influence directement les indicateurs de rentabilité projetée. Une hausse des taux freine les décisions impliquant des dépenses en capital importantes, telles que dans le secteur industriel ou les infrastructures. En revanche, un retournement de cycle accompagné d’une baisse progressive des coûts d’emprunt améliore la viabilité économique des projets. Dans ses rapports, la BEI observe une corrélation entre l’accès au crédit et l’intensité des investissements d’entreprise, notamment après les chocs macroéconomiques successifs.
Réformes structurelles nationales
Les transformations engagées par les États – dans les domaines de la réglementation, de la gouvernance, de l’urbanisme – peuvent rendre les environnements plus accessibles et moins incertains. Une clarté juridique accrue, une simplification des procédures liées aux permis et la réduction des instabilités réglementaires figurent parmi les critères regardés par les comités d’investissement. Les entreprises sont d’autant plus enclines à s’engager que les procédures sont lisibles et que les délais sont maîtrisables. Les diagnostics économiques soulignent que ces ajustements sont associés à une meilleure allocation des ressources et à une capacité renforcée à attirer des financements extérieurs dans les pays d’Europe centrale et orientale.
Effets concrets sur les décisions d’investissement
Plusieurs paramètres ont un impact important sur les arbitrages des investisseurs. Parmi ceux-ci :
Coût et accès au financement
Des coûts de financement élevés peuvent décourager les projets de long terme, en particulier ceux impliquant des usages intensifs en infrastructures ou en équipements techniques. Les structures de soutien public, comme la BEI ou les dispositifs européens de garantie, ont contribué à mettre en place des instruments capables d’atténuer cette contrainte, notamment dans des contextes instables.
Qualité et visibilité du portefeuille de projets
Les enveloppes allouées par les États membres et l’Union européenne structurent un ensemble cohérent d’initiatives dans les transports, l’environnement ou les infrastructures numériques. Ce cadre suscite l’intérêt de fournisseurs, de sociétés d’ingénierie et d’opérateurs de services souhaitant participer à des appels d’offres ou prendre part à des montages partenariaux.
Stabilité réglementaire
Un environnement propice, avec une fiscalité prévisible et des normes du travail bien définies, aide à accélérer les prises de décision. Les données agrégées depuis la crise de 2009 mettent en évidence que les rigidités administratives ainsi que le manque de clarté dans les régimes juridiques ont freiné les initiatives. À l’inverse, les juridictions qui rendent les démarches plus fluides tendent à bénéficier d’un regain d’intérêt des acteurs économiques.
Données géopolitiques et énergie
Au vu des événements récents, les entreprises ont commencé à réévaluer leur exposition régionale. Le déplacement partiel des chaînes de production vers l’Europe de l’Est, combiné à la diversification des ressources énergétiques, semble ouvrir de nouvelles perspectives. Certains pays profitent d’une activité accrue dans l’automobile, l’électronique ou la logistique, même si la volatilité impose une gestion différenciée et prudente selon le profil de risque par pays.
Les flux de capital-investissement témoignent de cette adaptation : après le repli de 2020, l’année 2021 a été marquée par une nette reprise des engagements dans cette région, portée par l’amélioration graduelle des fondamentaux et par l’appui constant des acteurs publics et parapublics.
Tableau comparatif des investissements
Le tableau ci-dessous résume les tendances observées, en reliant les leviers politiques avec les secteurs concernés. Il s’inspire des études institutionnelles précédemment mentionnées.
| Mécanisme politique | Impact observé | Secteurs concernés | Observations |
|---|---|---|---|
| Fonds communautaires / RRF | Diminution relative du coût du capital | Équipements publics, numérique, énergie, innovation | Intérêt pour projets alignés Union européenne ; accès par appels d’offres mixtes |
| Politique monétaire | Variation du coût d’opportunité et rentabilité des projets | Industrie lourde, construction | Planification attentive du déclenchement ; intégration de clauses de flexibilité |
| Réformes économiques | Allègement des incertitudes administratives | Immobilier, services informatisés | Sélection des pays ayant des dispositifs clairs d’autorisation |
| Situation géopolitique | Évolution des chaînes d’approvisionnement | Secteurs industriels, transport/logistique | Prudence sur le multi-pays ; impact sur choix énergie |
| Financement régional | Conditions d’émission et coûts des marchés locaux | Marchés obligataires publics/privés | Approches diversifiées selon les devises et maturités |
« En 2022, nous avons opté pour un site de production en Europe de l’Est avec des objectifs de sécurisation logistique. Deux considérations ont influencé notre choix: la disponibilité de soutiens financés par l’UE et la simplification des démarches administratives. Les premiers mois ont été marqués par un effort d’adaptation des structures de prix compte tenu des taux du moment, mais la combinaison entre aides publiques et garanties s’est avérée déterminante. Nous avons diversifié géographiquement pour limiter les aléas régionaux et mis en place des clauses de protection sur l’énergie. À terme, le démarrage s’est produit sans délais majeurs et la compétitivité globale du projet s’est révélée conforme à nos attentes. »
Les adaptations lentes des règles administratives, la volatilité des taux, le niveau de préparation des projets ou encore les incertitudes géostratégiques constituent quelques freins repérés. Les données recensées sur l’investissement confirment des lacunes persistantes, en particulier dans certaines zones après les crises successives.
Ils reposent sur des déclinaisons nationales ou régionales de la politique de cohésion et de la Recovery and Resilience Facility. Ils prennent la forme de subventions, de prêts bonifiés ou de garanties, orientés vers l’innovation, le numérique et les grandes infrastructures. Leur effet d’entraînement est documenté par diverses institutions.
Les relocalisations industrielles et la transformation énergétique pourraient constituer une source de dynamisme, notamment si les taux venaient à baisser. Le développement d’instruments de dette locaux reste à surveiller, de même que les impacts potentiels liés au contexte politique international.
Dans le contexte est-européen, les instruments publics jouent un rôle d’appoint dans les décisions d’investissement. Les budgets européens abaissent les freins initiaux, la politique monétaire dicte les temporalités de financement, et les réformes nationales influencent l’exécution. L’évolution géopolitique renforce par ailleurs l’attractivité relative de certains territoires pour les industries ou services. Pour les entreprises, l’enjeu reste d’identifier les dispositifs pertinents, d’ajuster les montages financiers et de privilégier les zones à gouvernance claire.
Sources de l’article
- https://www.economie.gouv.fr/files/files/PDF/Rapport_pisani-ferry_enderlein-VF.pdf
- https://www.conseil-etat.fr/publications-colloques/discours-et-contributions/les-grands-investissements-publics